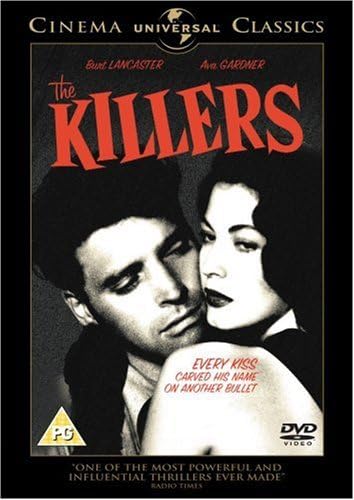THE KILLERS – 1946
The Killers (1946) : L’architecture du fatalisme selon Robert Siodmak
S’il ne fallait garder qu’un seul film pour définir l’essence même du film noir, The Killers (Les Tueurs) de Robert Siodmak serait sans doute l’élu. Sorti en 1946, au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, ce chef-d’œuvre ne se contente pas d’adapter une nouvelle d’Ernest Hemingway ; il transcende le matériau d’origine pour offrir une méditation visuelle et philosophique sur le destin, la trahison et la passivité face à la mort.
Alors que le cinéma américain de l’époque bascule de l’héroïsme patriotique de guerre vers un cynisme urbain désabusé, The Killers s’impose comme la pierre angulaire de cette transition. Produit par Mark Hellinger, un ancien journaliste de la côte Est devenu producteur, le film allie le réalisme brut du reportage criminel à l’esthétique cauchemardesque de l’expressionnisme allemand. Aujourd’hui, retour complet et détaillé sur ce monument, souvent qualifié de « Citizen Kane du film noir », qui marqua les débuts explosifs de Burt Lancaster et consacra Ava Gardner en déesse fatale.
1. L’Ouverture : Une réponse cinématographique à Hemingway
L’histoire de la production est presque aussi fascinante que le film lui-même. À l’origine, il y a une nouvelle d’Ernest Hemingway publiée en 1927 dans Scribner’s Magazine. Un texte court, sec, minimaliste, presque théâtral, qui avait la réputation d’être inadaptable tant il reposait sur le non-dit et « l’iceberg theory » chère à l’auteur. Le film relève le défi en s’ouvrant fidèlement sur cette base, reproduisant les dialogues à la virgule près pendant les douze premières minutes, une rareté absolue pour l’époque qui ancre le film dans une réalité littéraire avant de s’en envoler.
Deux tueurs à gages, Max (William Conrad) et Al (Charles McGraw), débarquent dans le Henry’s Diner de la petite ville de Brentwood, New Jersey. Vêtus de pardessus trop serrés et de chapeaux melons identiques, ils ressemblent à des jumeaux maléfiques ou à des croque-morts bureaucrates. Ils terrorisent le personnel, se moquent du menu (« Dinner is served from 6 to 8 » alors qu’il est à peine 17h) et cherchent un certain « Suédois ». Cette séquence est un modèle absolu de mise en place : la menace ne réside pas dans l’action immédiate ou l’explosion de violence, mais dans la banalité du mal, dans l’attente administrative de l’exécution. Les tueurs ne sont pas des monstres hurlants, mais des professionnels ennuyés, rendant la scène d’autant plus glaçante.
Du constat à l’enquête : La théorie de la « Réponse »
Mais là où la nouvelle d’Hemingway s’arrête brusquement — après que Nick Adams a prévenu le Suédois et que ce dernier, résigné, refuse de fuir — le film, lui, ne fait que commencer. Certains critiques, comme ceux de FilmsNoir.Net, analysent le scénario non pas comme une simple extension (ou « padding »), mais comme une réponse directe (« rebuttal ») à la dernière ligne d’Hemingway. Dans le livre, Nick Adams, jeune et incapable de supporter ce fatalisme, déclare : « I can’t stand to think about him waiting in the room and knowing he’s going to get it. » (Je ne supporte pas l’idée qu’il attende dans sa chambre en sachant qu’il va y passer). Il choisit de fuir la ville.
Le film, lui, refuse cette fuite. Il prend cette angoisse existentielle et décide de l’explorer jusqu’au bout. C’est ici que les scénaristes (Anthony Veiller, Richard Brooks et un John Huston non crédité pour des raisons contractuelles avec la Warner) interviennent pour transformer un instantané littéraire en fresque cinématographique. Ils posent la question que Nick Adams a fuie : pourquoi ?
« I did something wrong… once. » — Ole « The Swede » Andreson
C’est sur cette phrase que le film bascule. Il est crucial de noter la nuance apportée par rapport au texte original. Dans la nouvelle, le Suédois dit vaguement « I got it wrong » (Je me suis trompé). Le scénario modifie cette ligne pour lui donner un poids moral écrasant, une culpabilité presque biblique : « J’ai fait quelque chose de mal… une fois ». Cette modification est le pivot du film : nous ne sommes plus face à une erreur de calcul tactique, mais face à un péché originel qui exige expiation. Le Suédois ne meurt pas parce qu’il est piégé, mais parce qu’il accepte sa punition.
2. Le « Citizen Kane » du Noir : Une structure en puzzle
Pourquoi The Killers est-il inlassablement comparé au chef-d’œuvre d’Orson Welles ? Pour sa structure narrative audacieuse et fragmentée qui défiait les conventions linéaires de l’époque. Là où le film noir classique suit souvent une ligne droite descendante vers la déchéance (un homme honnête fait un mauvais choix et sombre), le film de Siodmak explose la chronologie pour mieux reconstruire une vie en miettes.
Le film se déploie à travers onze flashbacks distincts et complexes, imbriqués les uns dans les autres. Pour naviguer dans ce labyrinthe temporel, le film introduit un personnage original qui sert de fil d’Ariane : Jim Reardon (excellent Edmond O’Brien). Contrairement aux archétypes habituels du genre, Reardon n’est ni un policier cynique cherchant la justice, ni un détective privé alcoolique cherchant la rédemption. C’est un enquêteur d’assurance.
Une narration polyphonique
Cette architecture narrative permet de transformer un simple fait divers — le meurtre d’un pompiste dans une petite ville — en une tragédie grecque moderne. Reardon interviewe les témoins de la vie d’Ole Andreson, chacun détenant un fragment de la vérité :
Queenie, la femme de chambre, qui a vu sa tentative de suicide.
Le lieutenant Lubinsky (Sam Levene, touchant en ami d’enfance impuissant), qui a vu sa gloire et sa chute.
Lilly, l’ex-petite amie délaissée.
Charleston, le compagnon de cellule philosophe.
Chaque flashback est une pièce du puzzle, mais comme dans Citizen Kane, la vérité reste insaisissable, filtrée par la subjectivité, la mémoire défaillante et les regrets de chaque conteur. Siodmak nous montre que la vérité d’un homme n’est jamais entière, mais éparpillée dans le regard des autres.
3. Le Duo Mythique et la Galerie des Monstres
The Killers ne serait rien sans son casting légendaire, qui a défini les archétypes du genre pour les décennies à venir, mais aussi grâce à ses seconds rôles qui donnent au film sa texture si particulière.
Burt Lancaster, dont c’est le tout premier rôle à l’écran (il a été repéré dans une pièce de théâtre à Broadway peu avant), crève l’image dès sa première apparition. Ancien acrobate de cirque, il apporte une physicalité unique, une grâce lourde, au rôle d’Ole « The Swede » Andreson. Il incarne une masculinité tragique, une puissance brute rendue vulnérable par l’amour.
Sa passivité, allongée sur son lit dans l’ombre, attendant ses bourreaux en fixant le mur, reste l’une des images les plus iconiques du cinéma des années 40. Il ne tremble pas, il ne prie pas. Il est le boxeur qui a cessé de se battre, l’homme qui a compris que le destin frappe plus fort que n’importe quel adversaire sur le ring. Cette performance annonçait déjà la mélancolie physique qu’il déploierait plus tard dans des films comme Le Guépard ou The Swimmer.
4. Une esthétique de l’ombre et du son
Visuellement, le film est une leçon magistrale de style expressionniste. Robert Siodmak, ayant fui le nazisme en Europe, a importé à Hollywood les techniques de l’UFA et de l’expressionnisme allemand (les ombres portées, les angles de caméra débullés, les décors oppressants).
Le directeur de la photographie, Woody Bredell, utilise le clair-obscur non pas comme un simple artifice esthétique, mais comme une prison psychologique. Les ombres ne sont pas juste des absences de lumière ; elles sont des barreaux qui enferment le Suédois bien avant sa cellule de prison. Siodmak utilise abondamment la profondeur de champ, permettant de voir l’action au premier plan tout en gardant un œil sur une menace arrivant en arrière-plan, créant une paranoïa visuelle constante.
Le génie du plan-séquence : Le braquage
Il faut citer la scène du braquage de l’usine de chapeaux. Siodmak réalise ici un tour de force technique pour 1946 : un plan-séquence complexe, filmé à la grue. La caméra part d’une vue d’ensemble extérieure, s’élève, suit les braqueurs entrant dans l’usine, observe l’action à travers les fenêtres vitrées, puis redescend pour les suivre lors de leur fuite, le tout sans coupure apparente.
Cette fluidité contraste brutalement avec la rigidité du destin qui emprisonne les personnages. Ils bougent librement dans l’espace, la caméra vole avec eux, mais leur trajectoire temporelle est déjà figée vers la catastrophe. C’est une démonstration brillante que le mouvement n’est pas la liberté.
5. Un héritage immense : De Moscou à Hollywood
L’impact de The Killers dépasse largement 1946. Le film a engendré une lignée d’adaptations qui témoignent de la puissance du texte original d’Hemingway et de la vision fondatrice de Siodmak.
-
L’exercice de style de Tarkovsky (1956) : C’est une curiosité fascinante de l’histoire du cinéma. Andreï Tarkovsky, alors étudiant au VGIK (l’école de cinéma de Moscou), a réalisé sa propre adaptation en court-métrage avec ses camarades de classe (dont Aleksandr Gordon). Fasciné par l’ambiance et le fatalisme de la nouvelle (qu’il avait lue en traduction), il a tourné avec des moyens dérisoires, utilisant les couloirs de l’école pour figurer le diner américain. Bien que fauché, ce film d’étudiant capture l’atmosphère oppressante de la nouvelle avec une précision étonnante, préfigurant le génie visuel et la maîtrise du temps du futur réalisateur de Stalker et Solaris. C’est un pont improbable entre le Noir américain et le cinéma d’auteur soviétique.
-
La brutalité de Don Siegel (1964) : Don Siegel a réalisé un remake célèbre, initialement destiné à la télévision (le premier « TV movie » du genre) mais finalement sorti en salles car jugé trop violent pour le petit écran. Avec Lee Marvin et Angie Dickinson, le film est une réinterprétation radicale. Siegel délaisse la structure en flashbacks mélancoliques et le noir et blanc pour une approche linéaire, brutale, en couleurs vives et saturées.
L’anecdote la plus célèbre concerne Ronald Reagan, qui joue ici son tout dernier rôle au cinéma, et le seul rôle de « méchant » de toute sa carrière. La scène où il gifle violemment Angie Dickinson a choqué le public de l’époque. C’est un film « pop-art » et violent, là où celui de Siodmak était une peinture à l’huile sombre et romantique.
En résumé
Si la version de 1964 est un excellent thriller d’action et celle de Tarkovsky une promesse de génie, la version de 1946 reste supérieure par sa profondeur émotionnelle et sa complexité structurelle. C’est un film sur la perte : perte de l’innocence, perte de l’amour, et finalement, perte de la volonté de vivre.
The Killers de Siodmak est une véritable « architecture du fatalisme » où chaque poutre, chaque ombre, chaque note de musique soutient l’idée que l’on ne peut échapper à son passé. Le Suédois ne fuyait pas seulement des tueurs, il fuyait sa propre conscience. Et dans le monde du Noir, la conscience finit toujours par vous rattraper.
Vous avez vu ce film ? Êtes-vous plutôt « Team Siodmak » (l’ambiance) ou « Team Siegel » (l’action) ? Dites-le-moi en commentaire !
Mots-clés : #FilmNoir #TheKillers #RobertSiodmak #BurtLancaster #AvaGardner #Hemingway #CinémaClassique #CriterionCollection #EdwardHopper #MiklosRozsa #Tarkovsky