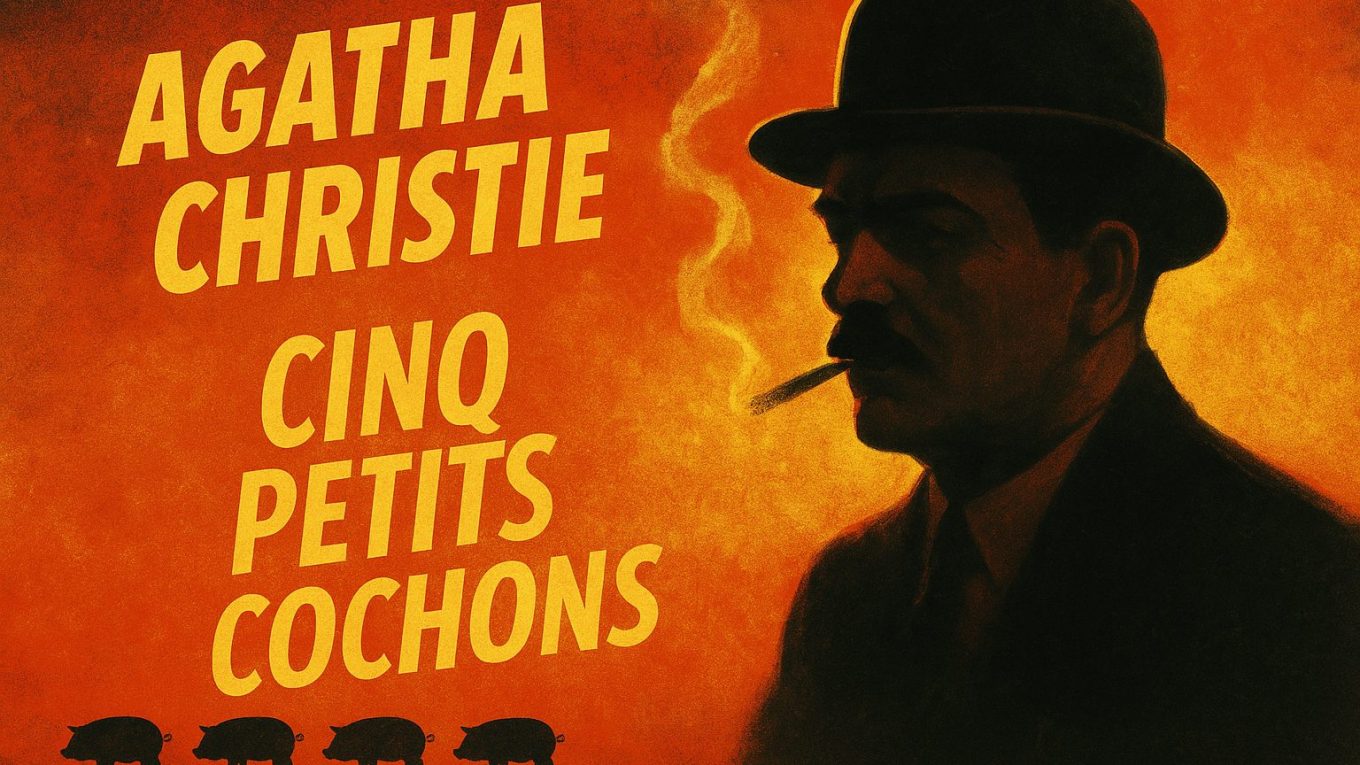Cinq petits cochons – Agatha Christie
📖 Fiche de lecture rapide
- Auteur : Agatha Christie
- Titre original : Five Little Pigs (US : Murder in Retrospect)
- Date de parution : 1942 (USA) – 1943 (UK) – 1947 (France)
- Collection : Collins Crime Club (UK), Le Masque (FR)
- Personnages clés : Hercule Poirot, Caroline Crale, Amyas Crale, Carla Lemarchant, Philip & Meredith Blake, Elsa Greer, Cecilia Williams, Angela Warren
- Thèmes principaux : Mémoire, culpabilité, jalousie, sacrifice, justice différée
- Particularité : Enquête à froid, 16 ans après les faits – 5 témoignages contradictoires
- Réception critique : Salué dès 1943 comme l’un des « Poirot de la grande époque »
- Adaptations :
- Go Back for Murder (pièce de théâtre, 1960)
- Série ITV Poirot avec David Suchet (2003)
- BBC Radio, John Moffatt (1994)
- Bande dessinée, Emmanuel Proust Éditeur (2009)
Cinq petits cochons d’Agatha Christie : quand la mémoire devient scène de crime
Introduction : un roman que le podcast ne suffisait pas à contenir
Dans l’épisode 10 de Chroniques Noires, nous avons ouvert ensemble le dossier Cinq petits cochons.
Mais ce roman d’Agatha Christie (publié en 1942–43) est si dense, si singulier, qu’un podcast n’en pouvait suffire.
Alors voici un complément : des coulisses, des anecdotes, des comparaisons, tout ce que l’oral n’a pu vous livrer.
Parce qu’écouter Poirot c’est une chose, mais creuser derrière la plume de Christie en est une autre.
1. Christie en 1942 : écrire au milieu des bombes
Le roman naît dans une Angleterre bombardée. Londres tremble sous les raids allemands, et Christie vit seule : son mari Max Mallowan est mobilisé au Moyen-Orient.
La romancière se partage entre son bureau de Hampstead et une pharmacie où elle apporte son aide.
Cette activité explique l’extraordinaire précision avec laquelle elle décrit les poisons. Dans Cinq petits cochons, elle choisit la coniine, substance extraite de la grande ciguë — la même qui emporta Socrate.
Ce choix n’est pas anodin : en pleine guerre, la mort par poison évoque une menace silencieuse, insidieuse, loin du fracas des bombes. Christie transpose dans son intrigue cette peur diffuse qui gangrenait les foyers britanniques.
Complément inédit au podcast : Christie, dans ses carnets (conservés et publiés par John Curran), note ses hésitations sur le choix du poison, preuve qu’elle voulait un effet symbolique. La ciguë évoque la philosophie, le destin, la condamnation injuste.
2. Une publication sous contraintes : l’Amérique d’abord, l’Angleterre ensuite
Autre fait marquant : Five Little Pigs est d’abord publié aux États-Unis en mai 1942, sous le titre Murder in Retrospect.
Pourquoi cette inversion ? Parce que le papier manque au Royaume-Uni. La guerre n’épargne pas les éditeurs : même la littérature doit attendre son tour dans l’économie de rationnement.
Ce décalage est révélateur : l’Amérique, encore éloignée des combats directs, pouvait se permettre de publier, d’imprimer, de consommer des romans policiers comme on consomme des cigarettes.
L’Angleterre, elle, lisait sous la lampe à pétrole et avec des journaux minces comme du papier bible.
La traduction française n’arrivera qu’en 1947, aux Éditions du Masque. Couverture jaune, traduction de Michel Le Houbie, et une France encore en reconstruction découvre cette tragédie intime venue d’Angleterre.
Complément inédit au podcast : Les archives du Masque montrent que ce roman fut un « succès modéré » en France à sa sortie, éclipsé par la popularité d’And Then There Were None (Dix petits nègres). Mais les rééditions ultérieures l’ont fait remonter dans le palmarès des lecteurs.
3. L’innovation narrative : cinq mémoires, cinq vérités
Le roman se distingue par sa construction.
Poirot enquête seize ans après les faits. Pas de scène de crime, pas de corps, pas d’indices matériels.
Seulement la mémoire.
Christie invente un dispositif audacieux : elle demande à chaque témoin d’écrire un récit complet de la journée du crime. Le lecteur se retrouve avec cinq chapitres entiers, cinq versions du même jour.
Ce n’est plus une enquête, c’est une mosaïque.
Ce choix rappelle les grands romans polyphoniques du XIXe siècle, comme La Pierre de lune de Wilkie Collins. Mais appliqué au genre policier, c’est une véritable révolution.
Et cette structure a une conséquence : elle transforme le lecteur en détective. C’est à lui de comparer, de remarquer les contradictions, de douter des omissions.
Un jeu intellectuel, mais aussi une réflexion sur la fragilité de la mémoire humaine.
4. Thèmes majeurs : mémoire, culpabilité, sacrifice
Là où d’autres romans de Christie brillent par leur mécanique, Cinq petits cochons s’impose par sa gravité.
Trois thèmes dominent :
-
La mémoire : comment se souvenir seize ans plus tard ? La mémoire n’est pas un enregistrement fidèle, c’est une réécriture. Chacun des témoins reformule le passé à son avantage.
-
La culpabilité : Caroline, l’épouse innocente, accepte la condamnation. Parce qu’elle croit sa sœur Angela coupable. Parce qu’elle porte déjà le poids d’une ancienne faute (l’accident qui a mutilé Angela).
-
Le sacrifice : Caroline se tait et se condamne, par amour et par remords. Rarement Christie avait donné une telle dimension tragique à un personnage féminin.
5. Réception critique : des éloges unanimes
Dès 1943, la critique britannique applaudit.
Le Times Literary Supplement loue l’« incroyable adresse » de l’auteure.
The Observer parle d’un « dénouement formidable ».
Et The Guardian note que Christie « ne déçoit jamais », ajoutant que l’indice final est « parfaitement satisfaisant ».
Aujourd’hui encore, les spécialistes tiennent ce roman pour l’un de ses sommets. Robert Barnard, grand critique, le place au sommet de son panthéon christien. Charles Osborne, biographe, souligne « la satisfaction et même l’émotion » que procure sa révélation finale.
6. Adaptations : de la scène au petit écran
-
🎭 Théâtre (1960) : Go Back for Murder. Christie supprime Poirot et centre l’histoire sur Carla et son avocat. Un choix révélateur de son agacement envers son héros. Succès modeste, 37 représentations.
-
📺 Télévision (2003) : ITV adapte le roman dans la série Poirot avec David Suchet. C’est l’un des épisodes les plus sombres, salué pour ses flashbacks stylisés et son intensité émotionnelle.
-
📻 Radio (1994) : la BBC diffuse une version de 90 minutes avec John Moffatt. Fidèle au texte, parfaite pour une intrigue faite de souvenirs et de voix.
-
📚 Bande dessinée (2009) : Emmanuel Proust Éditeur en publie une adaptation en France. Chaque témoignage y est différencié par une palette graphique, renforçant l’idée de subjectivité.
Complément inédit au podcast : Les carnets de production de la série ITV montrent que l’équipe craignait que l’absence d’action directe rebute le spectateur. Le pari fut gagné : l’épisode devint un des plus appréciés de toute la saga Suchet.
7. Héritage et comparaison
Ce roman a influencé d’autres auteurs.
La technique de l’« enquête à froid » se retrouve plus tard chez P. D. James (Une mort esthétique), ou chez Ruth Rendell.
Christie avait ouvert la voie à un polar plus psychologique, moins centré sur la scène de crime immédiate.
On peut aussi comparer Cinq petits cochons à Sad Cypress (1940), autre roman où l’émotion domine.
Mais ici, la gravité est plus marquée. On n’a pas seulement une énigme, mais une méditation sur la mémoire et l’injustice.
Conclusion : pourquoi relire Cinq petits cochons aujourd’hui ?
Parce que ce n’est pas seulement un « bon Christie ».
C’est un roman qui questionne la mémoire, la justice et le temps.
Un roman où Poirot se fait analyste, presque psychanalyste.
Un roman qui rappelle que la vérité, parfois, arrive trop tard.
Et dans un monde saturé d’images instantanées, cette enquête à froid garde une modernité troublante.
Que vaut un souvenir ? Peut-il faire condamner ou innocenter ?
Voilà la vraie question posée par Agatha Christie en 1942.